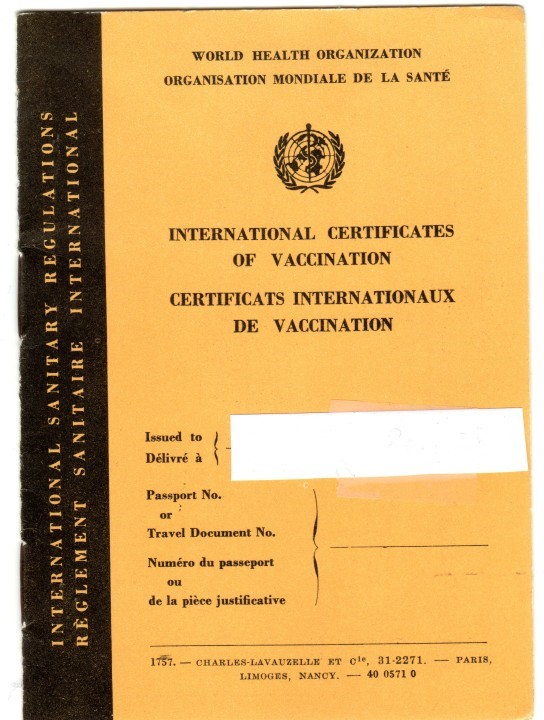Vicktor Douchkine, le fondateur de la Légion Rouge et le grand père de Jonas et de sa sœur Nika, était un ancien colonel de l’armée russe qui avait été responsable du service de renseignements des armées, la célèbre la GRU dont une partie des agents rejoindront la Légion Rouge suite aux purges commandées par Staline. Vicktor Douchkine a échappé à l’épuration sanglante de l’Armée entre 1937 et 38 par un Staline bien décidé à ne pas laisser un pouvoir quelconque capable de lui nuire un jour. Beria l’âme damnée de la NKVD, confia la besogne à un camarade la promotion de Douchkine, Nikolai Iéjov. Ce dernier faisant preuve d’un zèle impitoyable envoya à la mort ou dans les camps quelques 6 000 gradés. De juillet 37 à octobre 1938, tous les commandants de districts militaires et leurs chefs d’États-majors, les amiraux comme les généraux de l’aviation furent passés par les armes. La déclaration de la guerre avec l’Allemagne révéla les dégâts d’un tel abattage ce qui valut à Iéjov – ironie de la vie – d’être fusillé à son tour.
En 1940, Vicktor Douchkine est capitaine d’un régiment de blindés. Vite repéré pour ses qualités de tacticien, il inventa notamment la mode des chars enterrés, ce qui leur permettaient de tirer tout se protégeant et de constituer des embuscades qui surprenaient leurs adversaires. En 1941, Vicktor Douchkine devient un temps, l’aide de camp du maréchal Joukov puis il rejoint le général Timochenko qui a été désigné pour défendre la mer noire et le sud de Moscou. La collaboration entre ces deux hommes marquera les premières victoires russes sur les allemands en décembre 1942. Lors du remaniement du haut commandement militaire en 44, Timochenko est muté à Moscou. Avant de rejoindre la capitale, Timochenko qui craint pour son protégé l’envoi – contre son gré car il préférait revenir sur le front – rejoindre son ami Pavlov, chef du service du renseignement de l’Armée Rouge alors très actif en Suisse, en Italie et au Japon. A l’époque, la prise en main de l’appareil politique des réseaux de renseignements militaire – pudiquement désignés sous le nom de « renseignement diplomatiques » – était une vraie catastrophe. La plupart des données et des informations remontées par les réseaux militaires était interprétées sous un sens à priori favorable par le Politburo. Ainsi des renseignements précieux qui auraient sans doute pu donner une tournure bien différente du conflit entre les allemands et les russes restèrent bloqués par l’INO : Le service de la politique étrangère du MVD spécialisé, lui, dans le service de sureté intérieur de l’Etat. Malgré les avertissements répétés des renseignements militaires, Staline ne voulait pas envisager qu’Hitler se préparait à agresser l’URSS. Pour lui, l’Allemagne ne pouvait conduire deux guerres de front. Il se trompait et personne au Politburo ne souhaitait lui faire savoir. La pression politique et le déni était telle que l’un des amis de Vicktor, le colonel Makov fut accusé d’avoir fourni de faux renseignements. A partir de cette époque et durant toutes les années d’après-guerre les hauts gradés militaires, membres du GRU paieront un lourd tribu à la dictature rouge, pour se voir mis à l’écart de façon souvent brutale et, au mieux, récompensés par quelques médailles par les communistes peu soucieux de voir étaler leur incompétence.
Dans les années 50 à 70, si l’après-guerre avait fait perdre au GRU une partie de ses cadres et taillée dans ses moyens de financement, elle ne l’avait guère touché au cœur du réseau d’anciens cadres militaires soudés par des années de galères et d’amitiés de combats. Vicktor Douchkine, avec quelques camarades qui avaient rejoint Pavlov, décidèrent dans le plus grand secret d’organiser une amicale des officiers les plus fiables du GRU, considérés comme des durs, et moins politisés que leurs homologues du KGB. Bientôt, le réseau souterrain du GRU, sous la direction du colonel Vicktor Douchkine s’infiltra avec succès dans des activités parallèle aux services secrets du MVD puis du KGB et plus tard du SFB (Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie). Leur réseau n’avait pas de nom, pas d’organisation, pas de bureaux, pas de sièges ou de responsables, un cercle d’amis et de connaissances qui se retrouvaient régulièrement à l’Académie Militaire de Moscou à l’occasion de conférences. Ils se protégeaient les uns les autres des caprices du pouvoir rouge et pour vivre correctement dans leur retour à la vie civile. Les plus entreprenants se lancèrent avec succès dans les « affaires » n’hésitant pas à affronter les mafias locales mal organisées avec le soutien de leur ex- compagnons de guerre. Une amicale puissante, tenue à la discrétion la plus absolue, composée très majoritairement de hauts gradés militaires qui tentaient de survivre à l’après-guerre. A la disparition de Vicktor Douchkine, fin des années 90, le réseau des amitiés de combat dont il était un des fondateurs avait profondément muté. Ce réseau de l’ombre, devenue une amicale, s’était progressivement enraciné dans les différents rouages de l’administration d’Etat et de l’économie russe pour le seul bénéfice de ses membres, d’anciens gradés et de leurs alliés. Elle était devenue une mafia militaire efficace et sans pitié couvrant toute l’Europe de l’Est : on la connaissait sous le nom de la Légion Rouge. A sa mort, Vicktor Douchkine laissait derrière lui un de ses hommes de confiance, un dénommé Malto Gümüs qui avait la mission difficile de faire vivre la Légion Rouge et de retrouver son petit-fils qu’il avait tant délaissé de son vivant.
A suivre : Qui est Jonas Raveszac le Parrain de la Légion Rouge